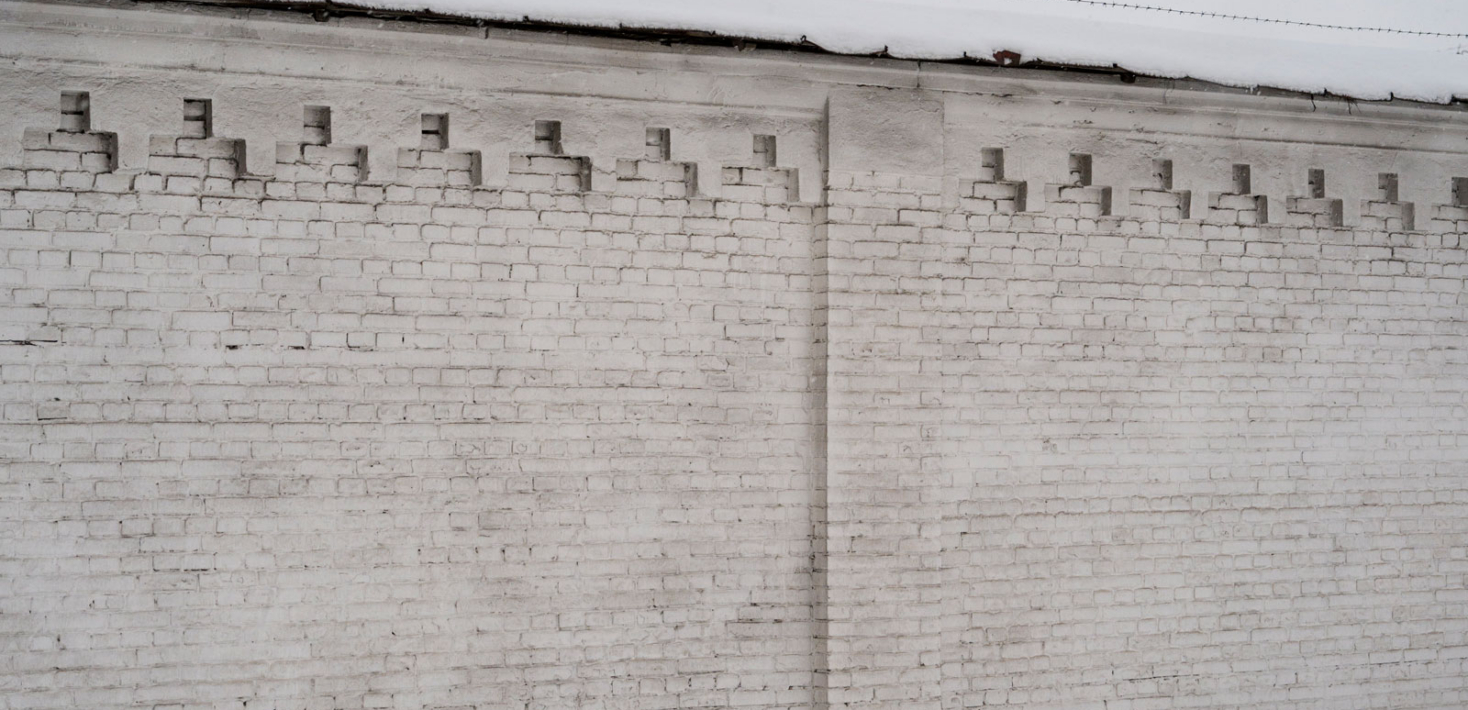L’ala kachuu, ou mariage par enlèvement, perdure au Kirghizistan bien que cette pratique soit criminalisée. Les victimes se retrouvent isolées, confrontées à la pression sociale. Soutenues par des associations, certaines commencent à porter plainte.
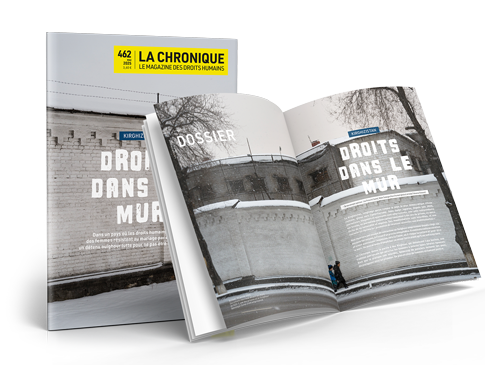
Extrait de La Chronique de mai 2025 #462
— De nos envoyés spéciaux : Léa Polverini (texte), Robin Tutenges/Hors Format (photos) et Aidai Tokoeva (fixeuse).
C’était en 1990, Saltanat a 20 ans et travaille dans une parfumerie. Kamchybek, un ouvrier de 29 ans, repeint la façade du magasin. Plusieurs fois, il propose de la raccompagner chez elle après son travail. Pendant ces trajets à pied, Saltanat aurait dû se méfier : l’homme demeurait silencieux. Un soir, alors qu’elle se couche, son patron téléphone : un problème d’inventaire à régler en urgence. Saltanat le retrouve à la parfumerie, mais, là, il l’invite à une fête. Elle hésite, puis finit par monter avec lui dans un bus privé, avec 15 inconnus. Au bout d’une heure, le bus emprunte une route de montagne, Saltanat s’inquiète : « Je vais devoir rentrer chez mes parents », ose-t-elle. « Après la fête ! Ne t’inquiète pas », la rassure son patron. Ils s’arrêtent devant une maison isolée. Les passagers descendent et sont conduits à l’intérieur, où une longue table est dressée avec du pain et des victuailles. Saltanat s’en veut d’avoir suivi ces inconnus, lorsqu’elle voit surgir un visage familier. Kamchybek. Une convive l’interpelle joyeusement : « Alors ?!… Elle est où, ta mariée ? »
Saltanat n’a pas le temps de réagir. Un groupe de femmes l’entoure et pose un foulard blanc sur ses cheveux. Un imam la déclare mariée. Les invités jubilent, elle fond en larmes et se souvient d’une phrase de sa mère : « Une fille est comme une pierre que l’on a jetée. Là où on l’a jetée, elle doit rester. » En ravalant ses larmes, elle se laisse emporter par ce qui s’appelle ici l’ala kachuu (« Attrape-la et cours », en français) : le mariage par enlèvement.
Dans la majorité des cas, la future épouse ne connaît pas son kidnappeur
— Rapport de l’Unicef (2019)

© Hors format
En 1990, Kamchybek a fait venir Saltanat à une fête : celle de son mariage forcé
Épouser son ravisseur, éviter la honte
Nadira Mukhamejan, spécialiste des questions de genre à l’université de Genève, nous explique cette tradition issue des nomades d’Asie centrale (Kirghizistan, sud du Kazakhstan, Turkménistan et Karakalpakstan). « À l’origine, l’ala kachuu officialisait des fugues consensuelles [organisées par des couples dont les familles refusaient l’union] ou des mariages arrangés, permettant parfois aux couples d’éviter les coûts élevés des mariages traditionnels. Après l’indépendance du Kirghizistan, en 1991, les difficultés économiques et le renforcement des valeurs patriarcales ont transformé cette coutume. Aujourd’hui, l’ala kachuu désigne généralement l’acte d’un jeune homme qui, souvent avec l’aide de ses amis et sous l’influence de l’alcool, enlève une jeune femme par tromperie ou par force. Emmenée dans la famille du marié, elle subit une pression psychologique, et parfois physique, pour accepter le mariage. » La chercheuse Kenza Rharmaoui, spécialiste des États post-soviétiques, décrit l’ala kachuu moins comme une tradition ancestrale que comme une pratique enracinée dans une culture sexiste et une culture du viol, qui s’est intensifiée ces dernières décennies pour devenir un outil de contrôle des femmes et de leur sexualité1. Elle souligne aussi que l’enlèvement suivi d’un mariage forcé est souvent « la manière la plus économique et rapide pour les hommes moins fortunés de se marier » (voir encadré).
« On kidnappait n’importe qui. Une fois, devant le bazar, mon cousin a kidnappé par erreur une femme mariée ! »
— Kamchybek, ancien « ravisseur »

© Hors Format
Il y a trente ans, Siyadat (à droite) a été enlevée puis mariée de force à Esenbek (à gauche). Ils vivent ensembleà Balyktchy, ville du nord-est du pays.
Trente-cinq ans ont passé depuis l’enlèvement de Saltanat. Nous la retrouvons à Balyktchy, une ville industrielle du nord-est du pays, où flotte une odeur âpre de plastique et de tissu brûlés. Kamchybek, son mari, a ouvert une boutique de babioles dans le bazar. Saltanat nous assure qu’après son enlèvement et le mariage forcé, la famille du mari avait parfaitement respecté la tradition : « Ses parents ont demandé aux miens s’ils acceptaient ce mariage. Ils ont dit non, mais moi, j’ai dit oui. » Elle se remémore cet instant pendant la noce où son mari, d’une voix douce, a déclaré la trouver « jolie avec son foulard blanc ». Puis elle ajoute « quand on a franchi cette porte, c’est fini, on ne peut plus repartir. Alors je suis restée ». La chercheuse Nadira Mukhamejan explique qu’« une femme enlevée est souvent obligée de suivre la tradition pour éviter la stigmatisation, car elle risque d’être perçue comme impure ou déshonorante si elle résiste ». Une célibataire qui passe une seule nuit hors de chez ses parents sera ainsi mal jugée si elle n’épouse pas son ravisseur… Kamchybek en rigole : « L’ala kachuu, c’est super pour les jeunes hommes timides qui n’osent pas aborder les filles et qui ont peur de construire une relation. » Il se dit nostalgique des années 1990, quand les hommes le vivaient avec fierté comme un rite viril : « Ça arrivait tout le temps ! On kidnappait n’importe qui. Une fois, devant le bazar, mon cousin a kidnappé par erreur une femme mariée ! »
Dans ce bazar, les hommes et les femmes que nous interrogeons le confirment. Ils parlent des enlèvements en échangeant des regards égrillards, parfois honteux. Ici, tout le monde connaît des couples qui se sont mariés après un kidnapping.
La criminalisation de l’ala kachuu
En 1994, une loi a interdit la pratique. Et en 2013, l’ala kachuu est devenu un crime, puni par des peines pouvant aller jusqu’à sept et dix ans de prison, selon que la victime est majeure ou mineure. Esenbek et Siyadat, la cinquantaine, regrettent que les jeunes ne soient plus autorisés à s’épouser ainsi : « Maintenant, les garçons ont peur. Les filles sont seules. » Il y a trente ans, Esenbek et deux amis se sont introduits de nuit dans la maison de Siyadat, qu’il fréquentait depuis des mois. Il désirait se marier vite, avant de rejoindre l’armée. Il l’a arrachée à son lit, avec ses complices. Elle aurait préféré qu’il s’y prenne autrement et organise une belle cérémonie de mariage arrangée par les deux familles. « Mon père dormait dans la chambre à côté. Quelque part, j’aurais voulu qu’il se réveille », glisse-t-elle, avant d’assurer vivre un « mariage heureux », qui lui a donné « deux beaux enfants ».

© Hors Format
Nurgiza, 36 ans, avec Sherzat, son fils aîné de 15 ans. Mariée de force à 18 ans, elle a fui il y a deux mois son mari violent. Avant de revenir vivre avec lui pour ses enfants.
Chaque année, 11 800 femmes sont mariées après un enlèvement estimait, en 2013, l’ONG kirghize Women Support Center, qui, depuis 1995, combat les violences exercées contre les femmes. Autre chiffre, émanant d’une enquête nationale sur les ménages, effectuée en 2011 et 20122 : un mariage sur trois impliquait en 2011 un enlèvement. Dans la moitié des cas, il s’agissait de mises en scène où l’enlèvement était accepté par les futurs époux. Mais pour l’autre moitié, la femme n’avait pas consenti. L’Unicef ajoute en 2019 que dans la majorité des cas la future épouse ne connaît pas son kidnappeur…
Nurgiza, 36 ans, fait partie de ces femmes. Elle nous invite à son domicile dans la banlieue de Karakol. Dans sa cuisine, elle découpe des quartiers de pommes qu’elle donne à son neveu, gambadant entre les deux pièces du petit appartement. Fille d’une femme kidnappée, Nurgiza a grandi dans la peur de l’être à son tour. Sur le chemin de l’école, elle s’organisait toujours pour être accompagnée par des camarades. En vain : le matin du 12 décembre 2007, alors qu’elle a 18 ans, elle se rend à pied à l’école d’institutrice lorsque trois inconnus la jettent dans une voiture. Conduite dans une maison éloignée, elle se retrouve face à un garçon de son âge qu’elle n’a jamais vu. Lui l’a repérée lors de funérailles. Nurgiza pleure, mais le mariage religieux suit son cours. Pour s’excuser du kidnapping, la famille du garçon envoie des cadeaux à celle de la jeune fille. La tradition le dicte : si les cadeaux sont acceptés, le mariage est confirmé. Veuve et mariée de force dans sa jeunesse, la mère de Nurgiza les refuse. Mais ses frères les acceptent, et pour amadouer leur nièce, ils lui promettent qu’elle pourra poursuivre ses études. Nurgiza obéit.
Le mariage s’avère un désastre. L’homme boit beaucoup, frappe son épouse à la moindre dispute et, un couteau à la main, menace de la tuer. Nurgiza compte bien sauver sa peau : « On dit en kirghize que les mauvaises femmes s’échappent 90 fois. J’ai été cette femme. » Après chaque fugue, elle revient à la maison, soumise à la pression d’une famille habituée à l’enlèvement des femmes : un cousin complaisant, un époux colérique, un fils anxieux ou une mère résignée. Comme l’atteste la chercheuse Nadira Mukhamejan : « Les familles jouent souvent un rôle clé, incitant la victime à accepter le mariage sous prétexte que refuser serait une honte et compromettrait ses chances de se marier. »
Sous pression sociale et familiale
La dernière fugue de Nurgiza remonte à deux mois. Elle a fui avec son fils cadet Mirzat à Bichkek, la capitale, où elle a trouvé un emploi dans une école privée. Le Défenseur des droits de Karakol l’a aidée à poursuivre son mari en justice, un juge a accordé le divorce, mais le jour où elle est revenue à la maison pour récupérer ses trois autres fils, accompagnée par la police et des travailleurs sociaux, Sherzat, son aîné, l’a suppliée de rester : « Il m’a dit que si on divorçait, il se pendrait, comme le fils des voisins », raconte-t-elle. Alors, vaincue, la mère a déposé son sac, renvoyé les policiers, et repris son rôle d’épouse.

© Hors Format
Le centre d’urgence de l’association Sézim accueille des femmes battues et leurs enfants, mais aussi celles qui ont fui un ala kachuu ou cherchent à divorcer.
Aujourd’hui, son mari disparaît chaque matin, pour ne rentrer que tard le soir sans jamais préciser où il va. Nurgiza suppose qu’il travaille quelque part, puisqu’il rapporte un peu d’argent. La plainte qu’elle a déposée contre lui a servi : il crie toujours sur elle, mais ne la cogne plus. Durant ses longues absences, Nurgiza profite de moments de liberté. Les enfants ont appris à garder le silence. Ils ne parleront pas des journalistes qui ce soir sont venus voir leur mère. Sherzat, du haut de ses 15 ans, rumine sa peine et nous confie des désirs de vengeance. Si son père ose encore lever la main sur sa mère, il sera là pour lui régler son compte.
Pour les femmes victimes, comme Nurgiza, de violences domestiques3, les structures d’accompagnement sont rares. À Bichkek, l’association Sézim est l’une des seules à leur proposer un soutien concret. Elle a ouvert plusieurs foyers destinés à les accueillir en urgence ou dans la durée, dont les adresses sont tenues secrètes pour des raisons de sécurité.
84 % des plaintes classées sans suite
Dans l’un de ces centres, nous rencontrons Gulmira4, 32 ans, arrivée une semaine plus tôt avec ses cinq enfants. Lorsqu’elle avait 19 ans, un inconnu l’a enlevée en voiture, l’a épousée de force et installée dans la maison de ses parents. Pendant des années, le mari et les beaux-parents l’ont frappée, elle, mais aussi ses enfants. Depuis qu’elle a trouvé la force de fuir en les emmenant, personne n’a cherché à la joindre : « Tout le monde pense que je reviendrai. Qu’est-ce qu’une femme avec cinq petits pourrait faire si loin de chez elle ? » L’année dernière, après une autre fuite suivie d’une tentative de suicide, ses propres parents l’avaient ramenée dans la famille de son ravisseur. Dans leur esprit, une épouse ne doit pas déserter son foyer. L’ala kachuu a beau être illégal, cette pratique est largement acceptée par les générations âgées, qui la considèrent comme une tradition inoffensive. Soumises à une forte pression familiale et sociale, rares sont les femmes qui osent faire appel aux tribunaux contre leurs kidnappeurs. L’ONG Women Support Center estimait en 2013 qu’une seule victime sur 1 500 engageait des poursuites judiciaires. Plus récemment, en 2021, le ministère de l’Intérieur comptabilisait 254 plaintes. Mais la chercheuse Nadira Mukhamejan juge que ce chiffre ne reflète que les plaintes officielles, et qu’il est probablement bien inférieur à la réalité. Le plus frappant, c’est que sur ces 254 plaintes, 84 % sont classées sans suite. « Oui, les condamnations sont rarissimes », confirme Rakya Rakhmatova, avocate en droit des familles pour Sézim. Selon elle, l’une des causes de l’impunité tient au comportement de la police. « La plupart des policiers sont des hommes. Ces derniers mois, une femme battue est allée porter plainte, et l’officier lui a répondu : “Mais madame, on ne vous a pas coupé les oreilles ni le nez, pourquoi vous voulez porter plainte ?” »
64 % des policiers d’Och, la deuxième ville du pays, considèrent le mariage npar enlèvement comme normal
— Ministère de l’Intérieur kirghize (2018)
Aizhan 4, enlevée à 17 ans, a fait une fausse couche après avoir reçu des coups violents de son époux. Elle raconte ce jour où, il y a plus de trois ans, elle a fait constater ses contusions et côtes brisées au commissariat du village. Quelques heures plus tard, le même policier était en train de discuter chez elle avec son mari : « Il lui expliquait que s’il retournait au commissariat avec la plainte, son supérieur le réprimanderait. » Une statistique de 2018 du ministère de l’Intérieur est édifiante : elle révèle que 64 % des policiers d’Och, la deuxième ville du pays, considèrent le mariage par enlèvement comme « normal ». De plus, 82 % d’entre eux estiment que les femmes « provoquent » elles-mêmes leur enlèvement. Ces préjugés ancrés au sein de la police ont-ils joué un rôle dans une affaire de féminicide survenue il y a quatre ans ? En avril 2021, à Bichkek, plusieurs hommes enlevaient en pleine rue Azaida Kanatbekova, une jeune femme de 27 ans. Sa mère, Nazgul, nous raconte la suite : « Pendant deux jours, nous avons remué ciel et terre pour retrouver ma fille. Au commissariat de police, un officier m’a conseillé d’un ton léger de préparer le mariage, en me disant que la famille du kidnappeur ne tarderait guère à m’envoyer l’achu basar » : la dot qu’adresse généralement la famille du kidnappeur pour demander pardon du « désagrément ». Le policier n’a donné aucun ordre pour engager des recherches.

©Hors format
Nazgul Kanatbekova attend toujours que la justice punisse les ravisseurs de sa fille, Aizada
Incurie policière
Deux jours plus tard, le corps d’Azaida était retrouvé dans une Honda Civic rouge abandonnée dans un champ. Son kidnappeur, âgé de 37 ans, gisait à ses côtés : il s’était tué lui-même de plusieurs coups de couteau après avoir violé et étranglé la jeune fille. En septembre 2024, le procès pour négligence du chef de la police de Bichkek, Bakyt Matmusayev, s’est conclu par son acquittement. « Pendant les audiences, tous les policiers convoqués ont témoigné en sa faveur. Aucun n’a pu préciser ce qu’il avait fait pour tenter de sauver Azaida », déplore Nazgul. La cour a condamné les quatre complices de l’enlèvement à verser chacun 20 000 soms (environ 200 euros) de dédommagement. « À peine le prix d’un pare-chocs », ironise l’avocat de Nazgul. À ce jour, aucun n’a réglé son amende. Mais l’histoire d’Azaida a marqué le pays. Après sa mort, plus de 500 personnes se sont rassemblées à Och et à Bichkek, devant le ministère de l’Intérieur et le siège du gouvernement, scandant « Honte ! » et réclamant la démission des chefs de la police. Des pancartes accusaient les autorités d’être « responsables du féminicide ». Le Premier ministre de l’époque Ulukbek Maripov a tenté d’apaiser la colère en promettant que les auteurs du meurtre de la jeune fille seraient punis. De son côté, le président Sadyr Japarov a qualifié, sur Facebook, le féminicide d’Azaida de « tragédie pour sa famille et pour tout notre État ». Pourtant, les responsables de la police de Bichkek sont restés en poste.

© Hors format
Après son enlèvement en 2021, Aizada, 27 ans, a été retrouvée morte deux jours plus tard. Gisant à ses côtés, son ravisseur s’était suicidé.
1– Kenza Rharmaoui, Le mariage par enlèvement au Kirghizistan : une pratique à l’épreuve du temps, Institut du Genre en Géopolitique, octobre 2021. 2– « Between tradition and modernity : marriage dynamics in Kyrgyzstan », Demography, juin 2015. 3– En 2021, le ministère de l’Intérieur kirghize recensait 10 151 plaintes pour violences domestiques. 4– Pour des raisons de sécurité, les noms ont été changés.
ENCADRE
Les motivations des ravisseurs, vues par les femmes
En 2016, les Nations unies ont questionné 6 000 ménages kirghizes sur les questions de genre*. Les enquêteurs ont demandé aux femmes pourquoi les hommes les enlèvent à des fins de mariage. Voici leurs réponses.
30 % « Le ravisseur ne veut pas que la femme épouse un autre homme. »
24 % « Le ravisseur a peur que la femme le rejette. »
21 % « Le ravisseur n’a pas osé faire la connaissance de la femme. »
18 % « Le ravisseur n’a pas d’argent pour payer le prix de la mariée. »
19 % « Les parents ou les proches ont insisté pour que la femme soit enlevée. »
10 % « C’est une forme traditionnelle de mariage. »
7 % « Les parents n’auraient pas approuvé le mariage. »