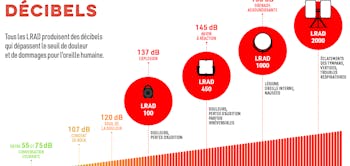La COP30 se tient du 10 au 21 novembre à Belém, au Brésil. Si certains critiquent le manque de résultats de ces conférences dédiées aux changements climatiques. D’autres estiment qu’elles sont un cadre multilatéral indispensable.
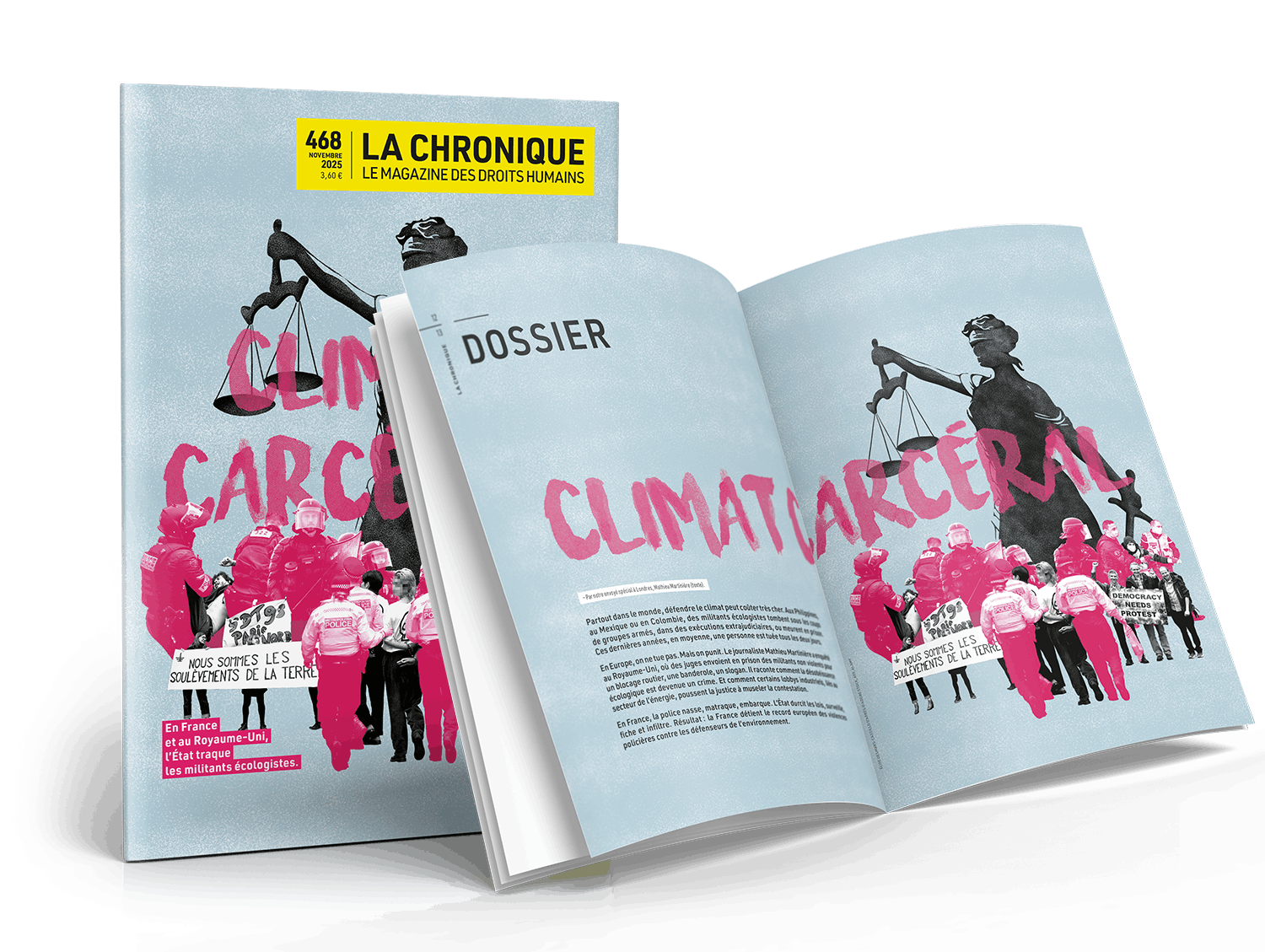
Extrait de La Chronique de novembre 2025 #468
— Propos recueillis par Théophile Simon

— Laurent Husson
Géologue au CNRS et membre du collectif Scientifiques en rébellion
Depuis la première édition à Berlin, en 1995, les COP (Conférence des Parties sur les changements climatiques) n’ont jamais tenu leurs promesses, même celle de Parisnen 2015, souvent présentée comme un succès. Quant aux deux dernières, à Dubaï enn 2023 puis à Bakou en 2024, elles ont tourné à la farce. À Dubaï, la conférence était présidée par le directeur général de la compagnie pétrolière émiratie, opposée à toute mesure ambitieuse. À Bakou, l’argent promis aux pays les moins avancés a été très inférieur aux attentes. Devant l’absence de résultats, certaines délégations ont claqué la porte. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, pourtant très affectée par le réchauffement, a même préféré ne pas s’y rendre.
L’impuissance des COP est congénitale. Dans un monde idéal, elles appliqueraient directement les recommandations des scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). En réalité, elles ne s’appuient jamais sur les rapports complets, mais sur le « résumé pour les décideurs », filtré parvles États ! Les délégués doivent donc trouver le plus petit dénominateur commun survun texte déjà édulcoré. Et même ce compromis n’a rien de contraignant ! La France, par exemple, est loin de ses objectifs de réduction des émissions de CO 2 . Elle ne reçoit aucune sanction.
Si les COP ne fonctionnent pas, tirons-en les leçons. Pas question de les supprimer intégralement, car les États n’auraient plus aucun intérêt à avancer. En revanche, je suis favorable à un mouvement de boycott qui pourrait éroder la légitimité des COP et provoquer un sursaut chez les organisateurs. Il faut frapper un grand coup, car la politique des petits pas est un leurre cultivé par les acteurs (lobbys et États) ayant intérêt au statu quo. Sondage après sondage, on voit que les citoyens sont beaucoup plus inquiets que ne le suggère l’attitude de leurs représentants. D’où l’urgence d’injecter une dose de démocratie directe dans les instances climatiques mondiales. Cela suppose une refonte des COP, structurée autour d’une base citoyenne, qui rendrait les renoncements impossibles et inacceptables. Un peu comme les Conventions citoyennes pour le climat, en France, mais dont les conclusions seraient appliquées.

— Carola Kloeck
Chercheuse en relations internationales au Ceri (Centre de recherches internationales, Sciences Po/CNRS)
Je comprends que les COP soient parfois perçues comme de grands raouts aux résultats décevants. On négocie depuis trente ans, et les émissions globales continuent d’augmenter ! Pourtant, elles ont le mérite d’exister : ce sont les seules rencontres internationales où les pollueurs et leurs victimes se retrouvent autour de la table.
L’attention médiatique, les rencontres et les débats qu’elles suscitent ont un effet performatif. Chaque année, les COP rappellent que le réchauffement climatique reste une urgence. Ce signal se propage ensuite dans les sphères économique, sociale, et même juridique. Ces dix dernières années, plusieurs cours de justice ont invoqué l’accord de Paris, un traité conclu lors de la COP21 en 2015, et son objectif de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 °C.
Je travaille beaucoup sur les nations insulaires, qui ne sont responsables que d’une infime part des émissions globales et dépendent donc de l’action des autres. Pour elles, les COP constituent des rendez-vous cruciaux : elles y font entendre leurs voix, décrochent des financements. En 2022, à Charm el-Cheikh, ces États ont ainsi obtenu la création d’un fonds « pertes et préjudices », destiné à compenser les dommages climatiques irréversibles. C’était une avancée majeure.
Certes, les décisions ambitieuses prises lors des COP sont rarement appliquées. Faut-il les en blâmer ? Je ne le pense pas. On pourrait envisager des votes plutôt qu’un consensus. Ils produiraient sans doute des résolutions plus audacieuses. Mais cela changerait-il vraiment la donne ? On peut en douter, car les principaux pays pollueurs – Chine, États-Unis, Arabie saoudite – pourraient alors décider de se retirer. Et sans eux, on ne produira aucune avancée réelle. L’impuissance des COP tient surtout au fait qu’il n’existe pas d’instances qui puissent sanctionner les manquements, ni de police du climat, pour obliger les États à respecter leurs engagements.
Autre problème : les COP sont devenues des événements démesurés, où les à-côtés (manifestations d’ONG, happenings politiques, etc.) prennent parfois le pas sur les négociations. Par ailleurs, tous les pays ne peuvent pas accueillir 50 000 participants. Réduire le format permettrait aux plus petites nations d’héberger ces conférences internationales. Et, peut-être, d’en tirer de meilleurs résultats.