Chaque année, des centaines de milliers de Français s’envolent pour la Thaïlande, attirés par ses lagons turquoise, ses bouddhas dorés et ses nuits sans sommeil. Mais, à l’extrême sud du pays, une guerre oubliée fait rage.
En réaction à une politique d’assimilation imposée aux populations malaises musulmanes, des groupes séparatistes ont pris les armes. Attentats, embuscades, exécutions : le conflit dure depuis vingt ans, loin des regards.
Nos journalistes ont rencontré ceux qui subissent la violence, mais aussi ceux qui frappent : militaires, et insurgés retranchés dans la jungle ou en exil.
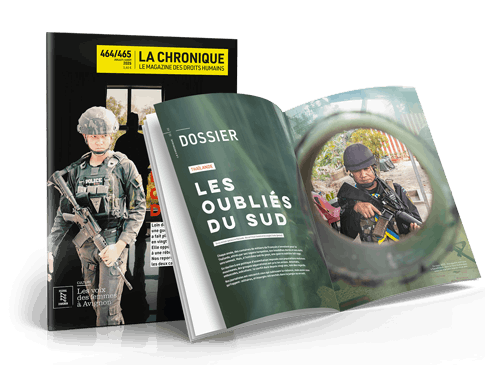
Extrait de La Chronique d'été # 464-465
— De nos envoyés spéciaux en Thaïlande : Marcel Tillion (texte) et Christophe Toscha (photos).
Assimilation sous loi martiale
L’armée thaïlandaise contrôle le sud du pays depuis vingt ans. Un général assure que les droits humains sont respectés. Mais des membres de la minorité malaise musulmane racontent une autre histoire.
La scène se déroule le 25 juin 2024, à 21 heures. Deux hommes masqués surgissent à moto devant une maison isolée du district de Yarang. Ils n’hésitent pas. En une rafale d’arme automatique, ils abattent Roning Dolah. Son corps s’effondre sur le pas de sa porte, sous les yeux de sa fille de 7 ans.
Quelques mois plus tard, sa veuve nous reçoit sous son toit, au milieu des rizières. Dans le petit salon, Kamilah nous accueille avec ses 5 enfants. D’une main, elle recoiffe Nasuha, la benjamine, blottie dans ses bras. Puis elle raconte : « Mon mari sortait pour acheter des fruits. Ils l’attendaient, vêtus d’uniformes noirs. Il s’est écroulé dans une mare de sang, devant notre fille. Elle ne dort plus depuis. » Ce soir-là, les hurlements des enfants se mêlent aux cris des voisins. L’un d’eux, sous le choc, transporte la dépouille à l’hôpital. La scène du crime a livré peu d’indices. Selon un rapport de la police locale, 7 douilles de 7 mm et une de 5 mm ont été retrouvées sur place.
La thaïfication du Sud
L’exécution de Roning Dolah, membre de la minorité malaise musulmane et défenseur des droits humains âgé de 45 ans, s’inscrit dans une guerre oubliée, toujours en cours en Thaïlande. Elle se concentre dans les provinces de Patani, Yala, Narathiwat et Songkhla, une enclave musulmane et malaise de 3,1 millions d’habitants dans un pays à plus de 90 % bouddhiste. Ces territoires de l’extrême sud formaient jadis un sultanat indépendant, annexé par Bangkok en 1909. Depuis, le royaume thaïlandais leur impose une politique d’assimilation linguistique, religieuse et culturelle. Il a banni des écoles le yawi, ce dialecte malais parlé dans ces provinces et écrit en alphabet arabe, et supprimé les tribunaux islamiques. La culture malaise en ressort marginalisée, remplacée par une éducation en langue thaïe et des symboles du bouddhisme national.
Pour s’opposer à cette « thaïfication », une résistance s’organise à partir des années 1960. Deux groupes séparatistes voient alors le jour : le Pattani United Liberation Organization (PULO) et le Barisan Revolusi Nasional (BRN). Ils réclament l’indépendance des quatre provinces et la création d’un État indépendant à majorité musulmane.
C’est en 2004 que le conflit bascule. Une série d’attaques contre des postes de la police fait une centaine de morts et déclenche une répression musclée : Bangkok envoie 50 000 soldats dans les quatre provinces et y instaure la loi martiale en donnant à l’armée tout pouvoir en matière de maintien de l’ordre et de sécurité. De nouveaux groupes armés, comme le Pattani Islamic Mujahideen Movement (PIMM), appellent à la guerre sainte contre l’armée et les civils bouddhistes. Les attentats indépendantistes se multiplient : ils visent des militaires, mais aussi des écoles, des marchés, des temples bouddhiques. Des enseignants sont abattus, des moines exécutés. L’armée riposte avec violence : elle conduit des raids, arrête des milliers de personnes, emprisonne sans procès, torture, fait disparaître. Depuis vingt ans, le conflit a fait plus de 7 700 morts et 15 000 blessés. En moyenne : un mort et deux blessés par jour, en majorité des civils, selon Human Rights Watch (HRW).
Roning Dolah, lui, n’a jamais participé à la lutte armée. Mais il était engagé aux côtés des victimes malaises. Soupçonné de séparatisme, il est arrêté en 2017 et torturé en prison. À sa libération, il devient le coordinateur du Duay Jai Group, une ONG soutenue par l’ONU, qui documente et dénonce les tortures en détention. « Il gênait l’armée, explique Kamilah, sa veuve. Ils l’accusaient d’être un insurgé terroriste, et, pourtant, Roning n’avait jamais pris les armes. »
Sa mort provoque l’indignation. HRW, Amnesty International/1, plusieurs agences des Nations unies dénoncent une exécution extrajudiciaire, mais aussi un climat d’impunité entretenu par les autorités. Car cette mort violente s’ajoute à une longue liste d’abus impunis : des prisonniers sans procès, des tortures jamais sanctionnées, des défenseurs des droits éliminés pour qu’ils se taisent.
Dans une maison du village de Bon Tom Makhan, près de Patani, le frère de Roning, Ashak Dolah, s’assoit en tailleur sur le sol du salon. Il tient à parler, lui aussi. Son sort est celui de nombreux hommes du Sud soupçonnés de sympathie pour la rébellion. En 2017, la police l’arrête, l’accusant d’appartenir au BRN, le principal mouvement séparatiste armé, et d’avoir participé à un attentat. « Je n’ai jamais eu de lien avec ce mouvement, jure-t-il. Et je n’ai jamais participé à un attentat. » Ashak Dolah ne peut pas se défendre : aucun procès ne se tient pour examiner les charges. Sans jugement, il est enfermé dans la prison de Songkhla, où il passera huit ans. Il partage alors une cellule de 100 m2 avec 140 autres hommes, pour la plupart accusés, eux aussi, de liens avec la rébellion. Les souvenirs affluent et font écho à d’autres témoignages, recueillis par les défenseurs des droits humains : « Ils mettaient des sacs plastique sur nos têtes pour nous étouffer. Ils nous frappaient avec des câbles électriques et des crosses de pistolet. Ils nous privaient de nourriture halal. Nous subissions des simulacres de noyade. » Libéré le 12 janvier dernier, Ashak reste sous surveillance. Chaque mois, des soldats frappent à sa porte. « Je leur demande ce qu’ils veulent, et leur réponse est toujours la même : “On vérifie que vous ne préparez rien.” »

Yala, 25 mars 2025. Kimi, assistante juridique, recueille les témoignages de deux femmes dont les maris ont été arrêtés la veille par l’armée.
« Les militaires ont littéralement tous les pouvoirs. Ils n’ont besoin d’aucun mandat pour fouiller, arrêter ou interroger »
— Kimi2, assistante juridique d’un cabinet d’avocats
Chez les avocates des Malais
Yala, 65 000 habitants. Capitale provinciale, cernée de collines et de bases militaires. Dans cette ville au climat tendu, nous avons rendez-vous avec des avocates qui défendent des Malais musulmans arrêtés sous la loi martiale. Leur bureau est dissimulé au fond d’une impasse du centre-ville. Elles sont trois. En ce moment, elles gèrent collectivement une cinquantaine de dossiers.
Kimi2, l’assistante juridique, nous reçoit dans une pièce éclairée au néon. Elle décrit un climat de pression constante : « Les militaires ont littéralement tous les pouvoirs. Ils n’ont besoin d’aucun mandat pour fouiller, arrêter ou interroger. Tout suspect, c’est-à-dire n’importe qui, peut être détenu jusqu’à trente jours sans mise en examen. »
Trois jeunes femmes pénètrent dans la pièce en silence. Le 14 mars, à l’aube, l’armée a arrêté leurs maris, Awae Saleh, Fadil Niksaw et Rushdi Lizar, accusés d’appartenir au BRN et d’avoir participé, quelques jours plus tôt, à un attentat à la bombe contre une patrouille militaire à Bannang Sata. Deux soldats sont morts. Hasina, épouse d’Awae, raconte d’une voix calme : « 20 militaires ont débarqué à la maison et ont tout retourné : matelas, armoires, tiroirs. Puis ils ont embarqué mon mari. J’ai peur qu’il soit battu. » Le père de Fadil est également venu chercher conseil. Il ne sait pas si son fils est coupable, mais il s’inquiète pour son sort en prison : « Je l’ai vu au parloir, il avait des marques sur le visage. Ils l’ont frappé. » Les avocates confirment ses craintes, au sujet des tortures : « Plusieurs clients racontent le même scénario : ils ont été immergés dans des bacs remplis d’eau glacée, puis interrogés dans des pièces où la climatisation est poussée à fond. C’est une façon de briser les corps sans laisser de marques. » Les familles parlent. Les avocates prennent des notes. Elles confronteront plus tard leurs récits aux procès-verbaux de police, à la recherche d’incohérences, d’aveux arrachés trop vite, ou falsifiés.
Arme blanche au checkpoint

Contrôle militaire à Yala, 25 mars 2025. Un soldat découvre un coutelas sur ce jeune homme malais.
En cette fin de ramadan, les quatre provinces du Sud sont sous tension. Les soldats thaïlandais quadrillent les rues, montent la garde devant les mosquées, les temples, surveillent les marchés, écoles, boutiques et restaurants. Un matin, nous obtenons l’autorisation d’observer un point de contrôle militaire sur la route reliant Patani à Narathiwat. Casqués, fusil M-16 en bandoulière, les soldats arrêtent tous les véhicules. Ils ouvrent les coffres, passent les motos au détecteur de métal, ciblant surtout les jeunes hommes malais. Sous nos yeux, ils contrôlent deux garçons à scooter. L’un d’eux dissimule une longue lame dans son pantalon de survêtement. Un soldat l’attrape par le bras et l’entraîne derrière un blindé. Ses collègues nous enjoignent de partir. On s’éloigne. Un officier, armé, s’avance vers nous, une GoPro fixée à son gilet pare-balles. « On filme tout, nous rassure-t-il. Pour éviter les bavures et les fausses accusations de violences policières. » Il appartient à une unité antiterroriste. Nous lui demandons, alors, comment évolue le conflit. « On approche de la fin du ramadan, période sensible. Il y a souvent, à ce moment-là, des attaques contre des civils, parfois contre des moines. » Les doigts sur son fusil, il désigne une voiture en cours de fouille. « Tout le monde peut être une menace. Mais moi, j’ai l’œil pour repérer le matériel explosif. » En avez-vous trouvé, aujourd’hui ? « Non, mais suivez-moi. » Il ouvre le coffre d’un pick-up et en sort une machette.

Patani, 27 mars 2025. Le lieutenant-général Paisan Nusang, chef des opérations de sécurité intérieure pour le Sud, à bord d’un hélicoptère Black Hawk après notre interview.
Plus au sud, sur le tarmac brûlant de l’aéroport militaire de Patani nous attend un officier responsable de l’application de la loi martiale. C’est le lieutenant-général Paisan Nusang en personne, commandant du 4e bataillon régional. Décoré pour ses opérations contre-insurrectionnelles, il nous accorde trente minutes, entre deux missions. Une occasion inespérée de questionner l’armée sur les arrestations arbitraires et la torture dont se plaint la minorité malaise de provinces du Sud. Serein, il rejette tout en bloc : « Ces pratiques n’ont plus cours. Chaque prisonnier est traité conformément aux droits humains. Nous ne tolérons aucun dérapage de nos soldats. » Mais son ton durcit lorsqu’il évoque les insurgés : « Nous défendons le royaume de Thaïlande contre les terroristes du BRN, quoi qu’il en coûte. Nous ne ferons aucune concession. Nous les traquerons jusqu’au dernier. » Il n’y aura pas d’autres questions. Un officier vient le chercher. L’hélicoptère est prêt, les pales déjà en rotation. Le lieutenant-général fait ses adieux poliment et saute à bord.
Résistance religieuse
Qui connaît Patani ? Un guide touristique décrit cette ville de 44 000 habitants comme « baignant dans une atmosphère authentique et locale ». Mais il la déconseille aux voyageurs en raison « d’attentats à la bombe, de fusillades et d’incendies criminels qui peuvent y survenir dans des lieux publics sans avertissement3 ». Ce n’est pas exagéré. Patani, c’est la mèche qui ne s’éteint jamais : la capitale historique de la résistance armée à la « thaïfication », ce long processus d’unification culturelle piloté par Bangkok, qui œuvre à imposer sa langue, son identité et son modèle bouddhique à l’ensemble du territoire. Ici, cette résistance ne passe pas seulement par les armes. Elle se manifeste aussi sur le terrain de l’éducation, de la langue et de la religion.
À 63 ans, Abdul Saleh en est un pilier. Il dirige les écoles coraniques des quatre provinces du Sud. Il nous reçoit dans un bureau austère, où un poster de La Mecque remplace le portrait du roi. « Le royaume thaïlandais a un objectif : effacer la langue malaise, et notre identité religieuse. Il veut les remplacer par le thaï et le bouddhisme, langue officielle et religion d’État. Nous, on s’y oppose », affirme-t-il posément. « Nous » ? C’est son réseau d’imams et d’enseignants coraniques qui transmettent aux enfants l’islam et leur histoire locale. « Dans nos écoles coraniques, on ne parle que malais. Pas un mot de thaï. » L’État laisse faire ? Il hésite. « Oui… mais pas toujours. En 2005, ils ont fermé l’une de nos écoles les plus importantes. »
« Le royaume a fermé notre école coranique pour nous empêcher de transmettre notre culture »
— Balyan Abdullah, fils d’un ancien leader du BRN exilé

Elle s’appelait Jihad Wittaya, et se trouvait à quelques kilomètres de Patani, dans le village de Talo-Kapo. Pour nous y rendre, nous sommes avec Balyan Abdullah, 41 ans. Fils d’un ancien leader du BRN exilé à l’étranger, il s’est assuré maintes fois qu’aucun agent thaïlandais ne le suivait avant de nous rejoindre, à l’orée d’une forêt humide. Le bâtiment est en ruine, à moitié englouti par la végétation, le sol jonché de débris et d’un Coran abandonné. Balyan s’arrête, ému, devant une petite mosquée décrépite. « Mon père l’a construite en 1968 avec des dons venus de Malaisie, murmure-t-il. Ici, on enseignait à près de 200 élèves, garçons et filles de 12 à 18 ans. » Pourquoi l’État l’a-t-il fermée ? « Il nous accusait d’endoctriner les enfants et d’y former des combattants terroristes. » Le 19 mai 2005, le Premier ministre thaïlandais avait déclaré à la radio : « Nous avons perquisitionné dans l’école Jihad Wittaya et trouvé des munitions, des preuves d’entraînement militaire et des CD d’entraînement d’Al-Qaïda qu’ils utilisaient pour leur lutte. » Balyan resserre sa chéchia sur son crâne. Il nie l’accusation : « C’est un mensonge. » Qui dit vrai ? Dans les années 1980-1990, les écoles coraniques comme Jihad Wittaya sont devenues des foyers de contestation. Dans les années 2010, HRW et l’International Crisis Group accusaient certains groupes armés de les infiltrer pour y recruter et former des combattants. Doonloh Waenano, père de Balyan qui avait créé l’école, dirigeait aussi la branche « formation militaire » du BRN. Le jour où la police et l’armée ont encerclé l’école, il a pris la fuite. Mais son fils insiste : « Ici, on enseignait la culture islamique aux enfants. Rien d’autre. Le royaume a inventé un prétexte pour nous empêcher de transmettre notre culture et nous imposer la sienne. » Don Pathan, chercheur associé à l’Asia Foundation et spécialiste des insurrections armées en Asie du Sud-Est, donne son avis sur la fermeture de Jihad Wittaya : « Je pense qu’il y a eu une exagération de la part du gouvernement. D’après mes informations recueillies dans les cercles politiques de la capitale, ce dernier voulait, en fermant cette école, s’attaquer aux grands leaders du BRN qui la finançaient. Mais cette mesure a nourri une résistance et même un extrémisme chez les Malais musulmans pratiquants. » Comme le notera, en 2016, le Bangkok Post4, « cette fermeture a créé un grand sentiment d’amertume parmi les musulmans du Sud ». Avant de repartir, Balyan lâche une phrase qui confirme le ressentiment d’une partie de cette population sous pression. Et, surtout, la mécanique sans fin de la violence : « Si certains d’entre nous prennent les armes, je ne les juge pas. À force d’être persécutés, nous devons bien nous défendre. »
1— Voir communiqué de presse du 27 juin 2024, sur amnesty.fr
2— Prénom modifié pour raisons de sécurité.
3— « Sécurité en Thaïlande : les endroits à éviter lors de votre séjour », sur https://lapetiterade.com
4— Bangkok Post, 20 mars 2016.
CHRONOLOGIE

1909
Le sultanat malais de Patani est annexé par le Siam (future Thaïlande).
Années 1940-1960
Politique d’assimilation forcée des Malais musulmans (langue, éducation, religion).
1963
Création du Barisan Revolusi Nasional (BRN), mouvement séparatiste pour l’indépendance de l’ancien sultanat de Patani.
1980–1990
Les écoles coraniques privées deviennent des foyers de contestation.
2004
Début de l’insurrection armée après des attaques du BRN.
Instauration de la loi martiale dans le Sud thaïlandais.
2020
Ouverture de négociations entre le BRN et les autorités thaïlandaises, à Kuala Lumpur (capitale de la Malaisie).
2023
Le BRN affirme vouloir épargner les victimes civiles.
2025
Recrudescence de la violence. Des civils sont tués. Négociations dans l’impasse.

Découvrez La Chronique sans plus tarder : recevez un numéro "découverte" gratuit
Remplissez ce formulaire en indiquant votre adresse postale et recevez gratuitement votre premier numéro dans votre boîte aux lettres !







