Quand le pire se normalise, votre soutien mensuel est un acte de résistance. Rejoignez-nous.
Espace journalistes
Contact presse
Pour toute demande d'interview ou recevoir nos communiqués de presse :
+33 6 76 94 37 05
Pour toute autre demande, contactez le standard au 01 53 38 65 65 ou notre Service Relations Membres et Donateurs par email : [email protected].
Espace journalistes
Contact presse
Pour toute demande d'interview ou recevoir nos communiqués de presse :
+33 6 76 94 37 05
Pour toute autre demande, contactez le standard au 01 53 38 65 65 ou notre Service Relations Membres et Donateurs par email : [email protected].
L’industrie mondiale de l’habillement tire profit du déni du droit de se syndiquer dans les principaux pays de production
Des patrons inflexibles
Deux nouveaux rapports révèlent que de grandes enseignes de la mode prospèrent sur le dos d’une main-d’œuvre sous-payée, majoritairement féminine, réduite au silence par la contrainte.
Des gouvernements, des usines et des marques mondiales de mode tirent profit de la répression constante des ouvrières et ouvriers de la confection et des violations de leurs droits du travail au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka, écrit Amnesty International dans deux rapports complémentaires publiés le 27 novembre 2025.
Ces deux rapports, intitulés Des patrons inflexibles. Les ouvrières et ouvriers de l’industrie de l’habillement privés de liberté syndicale au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka et Les oublié·e·s de la mode. Les marques doivent d’urgence défendre les droits des ouvrières et des ouvriers, font état de violations généralisées portant atteinte à la liberté syndicale dans l’industrie de l’habillement, qui se manifestent par des atteintes aux droits des travailleurs·euses et par des actes de harcèlement et de violence de la part des employeurs.
L’alliance détestable entre des marques de mode, des propriétaires d’usines et les gouvernements du Bangladesh, de l’Inde, du Pakistan et du Sri Lanka soutient une industrie connue pour ses violations endémiques des droits humains.
Agnès Callamard,
secrétaire générale d’Amnesty International
« L’alliance détestable entre des marques de mode, des propriétaires d’usines et les gouvernements du Bangladesh, de l’Inde, du Pakistan et du Sri Lanka soutient une industrie connue pour ses violations endémiques des droits humains. En ne respectant pas le droit des ouvrières et ouvriers de la confection à constituer des syndicats et à négocier collectivement, ce secteur prospère depuis des décennies grâce à l’exploitation d’une main-d’œuvre largement sous-payée, surchargée de travail et essentiellement féminine, a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International.
« Il s’agit d’une mise en accusation de l’ensemble du modèle économique de l’industrie de l’habillement, qui sacrifie les droits des travailleurs·euses au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka sur l’autel de sa quête incessante de profits pour les actionnaires d’entreprises de la mode majoritairement occidentales. »
Ces deux rapports s’appuient sur des recherches menées par Amnesty International entre septembre 2023 et août 2024, notamment sur 88 entretiens couvrant 20 usines dans les quatre pays. Parmi eux, 64 travailleurs et travailleuses, 12 dirigeant·e·s syndicaux et défenseurs·euses des droits du travail, dont plus de deux tiers de femmes. En novembre 2023, Amnesty International a également envoyé à 21 grandes marques et détaillants basés dans neuf pays, dont l’Allemagne, le Danemark, le Japon, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine, un questionnaire leur demandant des informations sur leurs politiques en matière de droits humains, le suivi et les actions concrètes liées à la liberté syndicale, à l’égalité des genres et aux pratiques d’achat. Adidas, ASOS, Fast Retailing, Inditex, le Groupe Otto et Primark ont fourni des réponses complètes. Beaucoup ont renvoyé des informations partielles, notamment M&S et Walmart, tandis que d’autres n’ont pas répondu, dont Boohoo, H&M, Desigual, Next et Gap.
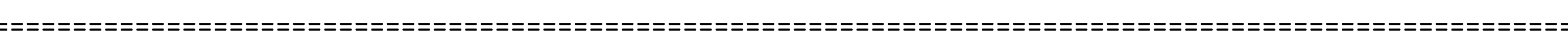
« Les managers nous crient dessus en nous disant que si nous rejoignons le syndicat, nous serons aussi renvoyés »
L’industrie mondiale de l’habillement fait depuis longtemps l’objet d’un examen pour les atteintes aux droits humains signalées dans ses chaînes d’approvisionnement et son modèle commercial. En Asie du Sud, les travailleurs·euses, en particulier les femmes, sont systématiquement privés de leurs droits en raison de contrats informels et précaires, de salaires de misère, de discriminations et de conditions de travail précaires.
Lorsque les travailleurs et travailleuses essaient de faire entendre leurs voix, ils sont ignorés. Lorsqu’ils tentent de s’organiser, ils sont menacés et licenciés. Enfin, lorsqu’ils protestent, ils sont battus, on leur tire dessus et on les arrête.
Taufiq*, membre d’une ONG de défense des travailleurs et travailleuses au Bangladesh
Dans les quatre pays étudiés, les ouvrières et ouvriers du textile ont déclaré qu’ils n’adhèrent pas à des syndicats par crainte de répercussions de la part des employeurs. Tous les syndicalistes interrogés par Amnesty International ont décrit un climat de peur dans lequel les contremaîtres et les directeurs d’usine harcèlent, licencient et menacent fréquemment les ouvrières et ouvriers au motif qu’ils fondent un syndicat ou en font partie, en violation flagrante de leur droit à la liberté d’association.
« Lorsque les travailleurs et travailleuses essaient de faire entendre leurs voix, ils sont ignorés. Lorsqu’ils tentent de s’organiser, ils sont menacés et licenciés. Enfin, lorsqu’ils protestent, ils sont battus, on leur tire dessus et on les arrête », a déclaré Taufiq*, employé d’une ONG qui défend les droits du travail au Bangladesh.

« Les violations des droits humains sont quotidiennes, dans chaque usine »
Les autorités des quatre pays se servent de nombreux moyens pour dissuader les travailleurs·euses de s’organiser ou les priver de leurs droits du travail par des pratiques antisyndicales, en entravant le droit de grève, comme les obstacles spécifiques à l’organisation syndicale dans les zones économiques spéciales (ZES), et en remplaçant les syndicats indépendants par des organes alliés de la direction.
Au Bangladesh, des restrictions juridiques privent les travailleurs et travailleuses du droit à la liberté syndicale dans les nombreuses zones économiques spéciales (ZES) où la majeure partie des vêtements sont confectionnés. Les ouvrières et ouvriers sont encouragés à constituer des associations ou des comités d’aide sociale, dont les moyens d’organisation et de représentation sont limités. Les autorités répriment avec violence les manifestations des travailleurs de l’habillement et instrumentalisent la loi pour sanctionner celles et ceux qui participent à des manifestations largement pacifiques.
En Inde, un grand nombre d’ouvriers et ouvrières à domicile dans l’industrie de l’habillement, qui travaillent en dehors de l’usine à la broderie ou à la finition des vêtements, ne sont pas reconnus comme des employés par le droit du travail du pays et ne peuvent donc pas bénéficier d’une retraite, d’allocations de protection sociale liées à l’emploi ou d’une affiliation à un syndicat.
Au Pakistan, les ouvrières et ouvriers de l’industrie textile luttent au quotidien pour obtenir un salaire minimum et des contrats de travail. Le sous-paiement des salaires en raison de l’absence de contrôles et de contrats en bonne et due forme, est endémique. En outre, la décentralisation de l’administration du droit du travail, ainsi que la répression antisyndicale généralisée imputable au gouvernement, ont conduit à un déni effectif du droit à la liberté syndicale pour les travailleurs et travailleuses des zones économiques spéciales (ZES).
Au Sri Lanka, les ouvrières et ouvriers des zones franches d’exportation (ZFE) se voient privés de leur droit à la liberté syndicale par des mesures administratives trop complexes qui dressent des obstacles souvent insurmontables à la formation d’un syndicat. Ceux qui parviennent à se syndiquer subissent harcèlement et intimidation, et sont souvent licenciés, car les autorités de l’État ne les protègent pas contre les représailles des propriétaires d’usines.

Les grandes enseignes mondiales de la mode – un allié précieux des gouvernements répressifs
Les entreprises de la mode contribuent à la vulnérabilité des ouvrières et ouvriers, car elles n’assument pas leurs responsabilités en matière de droits humains, transformant la diligence requise et les codes de conduite en QCM. Elles permettent le développement de chaînes d’approvisionnement opaques et se montrent disposées à se fournir en main-d’œuvre auprès de gouvernements et de partenaires commerciaux qui ne contrôlent pas les mauvaises pratiques au travail et n’y remédient pas, ou répriment activement la liberté syndicale. Du fait de l’absence de législation sur le devoir de diligence dans de nombreux pays, les marques ne sont pas tenues de rendre des comptes sur leurs chaînes d’approvisionnement, ce qui favorise une industrie d’extraction et d’exploitation. Lorsque ces lois existent, leur mise en œuvre et leur portée sont encore en projet.
Aux termes du droit international et des normes internationales, notamment des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et des Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les entreprises de la mode sont tenues d’identifier et de traiter tous les risques et les répercussions de leurs activités sur les droits humains en faisant preuve de la diligence requise à toutes les étapes de leur chaîne d’approvisionnement. Cependant, dans la plupart des États producteurs de vêtements, du fait de l’absence de législation contraignante, les atteintes aux droits des ouvrières et ouvriers s’enracinent dans les chaînes d’approvisionnement, sans que des mesures réelles ne soient prises en vue d’y remédier. En outre, les gouvernements des pays où ces marques mondiales ont leur siège n’ont pas pris de mesures afin d’empêcher les atteintes commises à l’étranger par des entreprises relevant de leur juridiction.
En raison du manque de transparence des chaînes d’approvisionnement mondiales, peu d’éléments permettent de déterminer si les politiques en matière de droits humains sont ou non mises en œuvre au niveau des usines. Les 21 enseignes de mode et détaillants interrogés ont tous des codes de conduite pour les fournisseurs, ou des politiques ou principes liés aux droits humains, qui affirment que l’entreprise s’engage à protéger le droit à la liberté syndicale des ouvrières et ouvriers. Malgré ce soi-disant engagement de la part des marques, Amnesty International a constaté que très peu de syndicats indépendants sont actifs au niveau des chaînes d’approvisionnement des entreprises de mode dans les quatre pays. Ce déni de la liberté syndicale et de négociation collective entrave les initiatives visant à prévenir, atténuer et réparer les violations des droits humains émaillant les chaînes d’approvisionnement.
« L’accès à la justice est généralement très limité pour toutes les
femmes… et c’est encore plus vrai pour les femmes dalits »
En Asie du Sud, la majorité de la main-d’œuvre de l’industrie textile est constituée de femmes, qui sont souvent des migrantes rurales ou des membres de castes marginalisées. Malgré leur nombre, elles sont sous-représentées dans la direction des usines, ce qui reproduit fréquemment le système patriarcal qui règne à l’extérieur, ainsi que les discriminations existantes fondées sur la classe, l’ethnie, la religion et la caste.
Les ouvrières du secteur de l’habillement déclarent subir régulièrement des actes de harcèlement, des agressions et des sévices physiques ou sexuels sur leur lieu de travail. Pourtant, elles obtiennent rarement justice. En raison de l’absence de mécanismes efficaces et indépendants pour recevoir leurs plaintes dans les usines dirigées par des hommes, des restrictions cautionnées par l’État en matière d’organisation et des menaces des employeurs vis-à-vis de celles qui se syndiquent, leurs souffrances perdurent.
« J’ai subi des attouchements physiques et des violences verbales. Aucun membre de la direction n’a voulu prêter attention à ma situation, alors j’ai demandé à d’autres femmes de s’organiser. J’ai été menacée de licenciement à de nombreuses reprises », a expliqué Sumaayaa*, une syndicaliste de Lahore, au Pakistan.
« La liberté syndicale est la clé qui ouvre la porte au changement dans l’industrie »
Comme l’a résumé le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association dans un rapport de 2016, « [L]es travailleurs privés de leurs droits de réunion et de libre association ont peu de moyens d’action pour faire évoluer des situations qui accentuent la pauvreté, creusent les inégalités… » Le Comité du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) indique clairement que « les droits syndicaux, la liberté syndicale et le droit de grève sont déterminants pour l’instauration, la préservation et la défense de conditions de travail justes et favorables ».
Amnesty International demande aux États de veiller à ce que toutes les ouvrières et tous les ouvriers puissent exercer leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, notamment en ayant la possibilité de constituer des syndicats et d’y adhérer au niveau des usines. Les États doivent aussi enquêter sur toutes les violations éventuelles de la législation du travail et d’autres lois pertinentes. En cas d’infraction avérée, ils doivent dûment sanctionner les employeurs, y compris par le biais de poursuites en justice, et accorder des réparations adéquates et en temps voulu aux personnes lésées.
Les entreprises doivent de toute urgence prendre des mesures concrètes afin de protéger les droits des travailleurs·euses dans leurs chaînes d’approvisionnement et de favoriser l’autonomisation des ouvrières. Il importe de mettre en place un système de diligence raisonnable obligatoire afin de garantir que les marques demandent des comptes aux usines sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement mondiale et, surtout, qu’elles garantissent des voies de recours aux victimes de violations des droits humains et permettent de prévenir toute violation future.
L’heure est venue d’élaborer une stratégie d’approvisionnement respectueuse des droits humains pour l’industrie mondiale de l’habillement.
Agnès Callamard
« L’heure est venue d’élaborer une stratégie d’approvisionnement respectueuse des droits humains pour l’industrie mondiale de l’habillement. Une stratégie qui garantisse une véritable liberté syndicale, sanctionne les entraves à son exercice, interdise les représailles contre les syndicats et réexamine l’approvisionnement auprès de tout site qui priverait les travailleurs et travailleuses du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, a déclaré Agnès Callamard.
« La réussite économique de l’industrie de l’habillement doit aller de pair avec la réalisation des droits des travailleuses et travailleurs. La liberté syndicale est essentielle pour lutter contre les violations de leurs droits. Elle doit être protégée, promue et défendue. »
* Noms modifiés pour préserver l’anonymat.

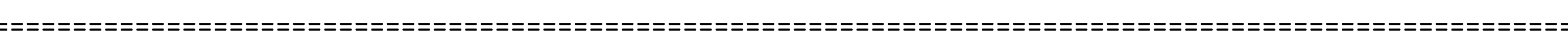
Ashila Dandeniya. Un traitement équitable des travailleurs et travailleuses pour une mode équitable
Mon premier emploi a été dans le secteur de l’habillement en 2001, en tant que contrôleuse qualité chez un fabricant de vêtements bien connu à Colombo, au Sri Lanka. J’ai rejoint le secteur juste après avoir terminé mes examens de fin de l’enseignement secondaire, car ma famille faisait face à des difficultés financières. Au fil du temps, j’ai commencé à parler des problèmes rencontrés par les ouvriers et ouvrières au sein du comité de travailleurs établi dans l’usine –, il n’y avait pas de syndicat là-bas. Cela a entraîné mon licenciement.
Comme je trouvais que c’était injuste, j’ai porté plainte contre l’usine. J’ai étudié le droit, j’ai pris connaissance de mes droits et j’ai décidé de me représenter moi-même devant les tribunaux… et j’ai gagné !
Lorsque j’ai reçu une compensation, cela m’a inculqué la conviction que nous pouvons gagner – si nous nous battons, nous pouvons garantir nos droits. En tant que travailleuse du secteur de l’habillement, je n’arrêtais pas d’intervenir dans les problèmes rencontrés par les ouvriers et ouvrières. C’est ce qui a conduit au lancement de Stand Up Movement Lanka.
« Les usines craignent notre intervention »
Lorsque nous recevons des signalements de pratiques de travail ou de licenciements injustes, nous nous efforçons de garantir la justice. Cependant, il y a un sentiment palpable de peur. Par exemple, une travailleuse a fait l’objet de représailles sur son lieu de travail pour avoir visité notre bureau dans son uniforme. C’est à ce moment-là que nous avons compris que les usines surveillaient de près notre bureau. Chaque fois qu’un ouvrier ou une ouvrière nous rend visite en uniforme, la direction de l’usine en est informée dès le lendemain. Ils ont peur de notre intervention.
Nous travaillons sur des questions relatives à la protection et à la promotion des droits des travailleurs et travailleuses. Un ouvrier ou une ouvrière du secteur de l’habillement sacrifie sa vie à poursuivre les objectifs de quelqu’un d’autre, tout en osant à peine rêver des siens.
Les salaires dépendent souvent de la réalisation d’objectifs difficiles à atteindre, ce qui signifie qu’en usine, les ouvriers et ouvrières de l’équipe s’inquiètent souvent si une personne fait une pause ou ralentit, même s’il s’agit simplement d’aller aux toilettes. Cela a conduit à une concurrence néfaste qui crée une animosité excessive parmi les ouvriers et ouvrières, car ils travaillent sous pression jour après jour. Tout cela afin qu’ils puissent atteindre les objectifs de l’entreprise dans un court laps de temps et payer leur prochain repas. Leur bonheur, leur tristesse, l’éducation de leurs enfants et leurs besoins nutritionnels dépendent tous de leur salaire.
Dans les zones franches d’exportation du Sri Lanka, la main-d’œuvre se compose principalement de jeunes femmes célibataires qui ont émigré de villages éloignés et défavorisés, vivant temporairement dans ces zones. Des membres de la communauté LGBTQI travaillent également dans ces zones. Les échelles salariales des travailleurs sont déterminées par leur genre. La majorité des travailleurs en bas de la chaîne, tels que les opérateurs de machines, sont des femmes, et leurs salaires sont faibles. Dans les postes qui offrent des salaires plus élevés, comme ceux au-dessus du niveau de superviseur, il est rare de voir une femme.
Des efforts ont été déployés pour exploiter ces travailleurs et travailleuses sous prétexte de fournir des conditions de travail flexibles. Cela a entraîné une informalisation croissante du secteur et une réduction des heures de travail tout en attendant des ouvriers et ouvrières qu’ils atteignent leurs objectifs. Ils sont également confrontés à une suppression de leurs divers avantages sociaux, à une réduction des salaires, et sont poussés plus profondément dans la pauvreté. Cette situation malheureuse n’est pas endémique au seul secteur de l’habillement du Sri Lanka, mais est enracinée dans des problèmes mondiaux.
« La lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses est une lutte régionale »
Nous travaillons souvent en étroite collaboration avec des organisations de la société civile et des syndicats régionaux similaires et avons remarqué que les ouvriers et ouvrières de l’habillement sont souvent exploités de la même manière partout. Par conséquent, nous pensons que notre lutte pour améliorer la vie des travailleurs et travailleuses doit être menée au niveau régional, et nous devons lutter ensemble pour cela.
C’est aux gouvernements de prendre la responsabilité de formuler des principes de base pour améliorer la vie des travailleurs et travailleuses de l’habillement. Au lieu de cela, ils ne tiennent pas compte des besoins des travailleurs et travailleuses et se concentrent sur les investisseurs lorsqu’ils formulent leurs politiques et leurs cadres juridiques. Cela indique aux usines que les pratiques d’exploitation sont acceptables tant qu’elles apportent des investissements dans le pays.
Les grandes enseignes mondiales de la mode ont également une plus grande responsabilité pour s’assurer qu’elles ne sont pas liées à des atteintes aux droits humains. Pour ce faire, les marques doivent prendre l’initiative de s’assurer que les travailleurs et travailleuses gagnent un salaire décent ou que les droits liés au genre sont protégés dans les usines avec lesquelles elles font affaire, même indirectement. Pour concrétiser leur engagement en faveur des droits humains, ces marques doivent se pencher sur le lieu où elles s’approvisionnent en main-d’œuvre et dire « NON » aux pays qui n’autorisent pas les syndicats et qui ne respectent pas les droits du travail, jusqu’à ce que ces changements aient lieu. Ce niveau d’engagement peut vraiment faire la différence dans nos vies.
Nous remarquons souvent que les gens semblent se sentir bien lorsqu’ils portent des vêtements à la mode, mais derrière cette satisfaction se cachent le sacrifice, le sang, la sueur et les larmes d’innombrables travailleurs et travailleuses, qui sont souvent oubliés. J’appelle chaque personne à y réfléchir lorsqu’elle porte des vêtements et à se demander si elle sait où et comment ses vêtements sont fabriqués, et si elle peut vraiment se sentir heureuse de les porter.

Ashila Dandeniya, 45 ans, était une ouvrière dans le secteur de l’habillement au Sri Lanka avant de fonder « Stand Up Movement Lanka ». Créée il y a plus de dix ans, l’organisation s’est engagée à protéger et à promouvoir les droits des travailleurs et travailleuses au Sri Lanka et collabore également avec d’autres syndicats de la région de l’Asie du Sud. Ces réseaux et syndicats, avec le soutien d’organisations comme Amnesty International, aident les travailleurs et travailleuses à se rassembler, à être collectivement entendus et à revendiquer leurs droits.

The post L’industrie mondiale de l’habillement tire profit du déni du droit de se syndiquer dans les principaux pays de production appeared first on Amnesty International.
Espace journalistes
Contact presse
Pour toute demande d'interview ou recevoir nos communiqués de presse :
+33 6 76 94 37 05
Pour toute autre demande, contactez le standard au 01 53 38 65 65 ou notre Service Relations Membres et Donateurs par email : [email protected].

