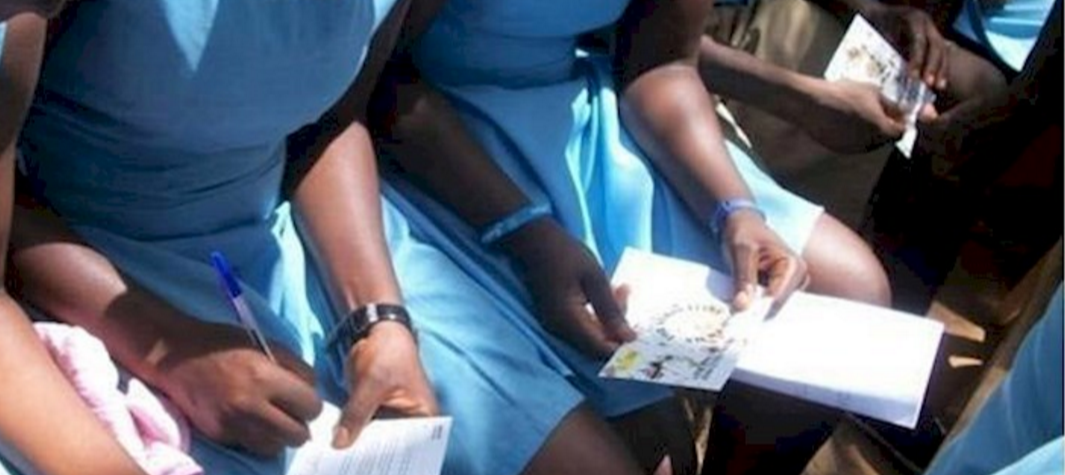Chaque année, nous publions notre Rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde. Un an d’enquête, 150 pays analysés. Voici ce qu’il faut savoir sur les droits humains au Ghana en 2024.
Le droit à la liberté de réunion pacifique a fait l’objet de restrictions. Cette année encore, les droits des femmes et des filles ont été menacés. Une loi sur la discrimination positive visant à promouvoir l’égalité des genres a enfin été promulguée. Une proposition de loi contre les personnes LGBTI a été adoptée au Parlement, mais le texte faisait l’objet de recours juridiques, ce qui retardait sa promulgation. Des progrès importants ont été accomplis dans la lutte contre le paludisme. L’exploitation minière illégale nuisait à l’environnement et aux moyens de subsistance des cultivateurs et cultivatrices de cacao.
CONTEXTE
En janvier, six personnes, dont trois soldat·e·s, ont été condamnées à mort pour leur participation à une tentative de coup d’État en 2021. La Constitution autorisait toujours la peine capitale pour les actes de haute trahison.
Malgré un fort ralentissement depuis la période d’hyperinflation observée en 2023, l’inflation des prix à la consommation demeurait élevée et s’établissait à 23,8 % en décembre. En octobre, les créanciers obligataires internationaux ont convenu de réduire de 37 % la dette du Ghana, qui atteignait 13 milliards de dollars des États-Unis. Une pénurie de gaz a entraîné de fréquentes coupures d’électricité.
John Dramani Mahama a remporté l’élection présidentielle en décembre.
LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DE RÉUNION
Le Ghana occupait le 50e rang (sur 180 pays) du Classement mondial de la liberté de la presse 2024 établi par Reporters sans frontières, gagnant 12 places par rapport à l’année précédente. Cependant, cette année encore, de nombreux journalistes ont fait l’objet de manœuvres d’intimidation et de violences.
En janvier, à Yendi, un journaliste a été agressé physiquement par un député du parti au pouvoir et plusieurs de ses sympathisant·e·s lors des primaires parlementaires organisées par ce parti en vue des élections générales de décembre. En mai, l’Association des journalistes du Ghana a appelé tous les responsables politiques à condamner les attaques visant des membres de la profession après l’agression physique d’un autre journaliste par des sympathisant·e·s du parti au pouvoir dans la ville de Tamale, où il couvrait des événements politiques.
Au mois de juillet, une manifestation prévue dans la capitale, Accra, pour réclamer une action des pouvoirs publics face à la crise du coût de la vie a été interdite à la demande de la police, qui a invoqué un manque d’effectifs pour assurer la sécurité. Plus de 50 personnes ont été arrêtées en septembre lors de manifestations organisées à Accra pour dénoncer la corruption présumée des autorités face à l’exploitation minière illégale. Toutes ont été libérées par la suite mais, à la fin de l’année, 31 d’entre elles étaient toujours sous le coup de divers chefs d’accusation, dont ceux de rassemblement illégal, de dégradations illégales et de « comportement offensant ayant entraîné des troubles à l’ordre public ».
DROITS DES FEMMES ET DES FILLES
Cette année encore, les droits des femmes et des filles ont été menacés. En avril, des militant·e·s ont condamné le mariage d’une enfant de 12 ans à un prêtre. La jeune fille a été placée sous protection policière, mais aucune arrestation n’a eu lieu.
Toujours en avril, la Commission des droits humains et de la justice administrative a organisé un dialogue avec 25 parties prenantes, dont des représentant·e·s de l’État, qui ont appelé le président à promulguer la loi érigeant en infraction les accusations de sorcellerie adoptée par le Parlement en 2023. Dans les régions du Nord et du Nord-Est, des centaines de femmes accusées de sorcellerie vivaient toujours dans des « camps de sorcières », où elles avaient trouvé refuge après avoir été rejetées par leur entourage.
La Loi sur la discrimination positive et l’égalité des genres, destinée à accroître la participation des femmes à la vie publique, a été adoptée par le Parlement en juillet et promulguée par le président en septembre. Cette nouvelle loi devait porter la participation des femmes à 30 % d’ici 2026 et à 50 % à l’horizon 2030.
DROITS DES PERSONNES LGBTI
Les droits des personnes LGBTI ont été encore affaiblis. Le Parlement a adopté en février une proposition de loi relative aux droits humains en matière de sexualité et aux valeurs familiales, qui introduisait de nouvelles sanctions pénales contre les personnes LGBTI et instaurait des peines d’emprisonnement pour quiconque plaiderait en faveur des droits de ces personnes. En mars, le président a déclaré qu’il attendrait la décision de la Cour suprême au sujet de la légalité de ce texte, qui faisait l’objet de deux recours juridiques, avant de décider de le ratifier ou non. En décembre, la Cour suprême a rejeté ces deux recours, affirmant qu’elle ne pouvait pas les examiner puis que le texte n’avait pas encore force de loi. Le président n’avait toujours pas promulgué cette loi à la fin de l’année.
En juillet, rejetant une requête en inconstitutionnalité qui invoquait des violations du droit au respect de la vie privée, la Cour suprême a maintenu l’article 104 du Code pénal de 1960 (Loi no 29), qui érigeait notamment en infraction la « connaissance charnelle contre nature ». Cette disposition était interprétée comme incluant les relations consenties entre personnes de même sexe.
DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Les prix des denrées alimentaires sont demeurés élevés, compromettant les droits à l’alimentation et à la santé. Selon un article de la BBC paru en juillet, les jeunes réalisaient des économies en consommant moins de protéines et en prenant moins de repas. L’inflation sur les produits alimentaires a atteint 29,6 % en mars.
Des progrès ont été accomplis en matière de lutte contre le paludisme. L’OMS a annoncé en avril que plus de 700 000 enfants de sept régions étaient vaccinés en septembre 2023, et que la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans était passée de 20,6 % en 2016 à 8,6 % en 2023. Toujours selon l’OMS, le nombre de décès de malades hospitalisés pour une crise de paludisme a chuté de 428 en 2018 à 155 en 2022.
En septembre, l’UNICEF a indiqué que le Ghana avait administré un million de doses de vaccin antipaludéen depuis 2019, réduisant considérablement le nombre de cas de paludisme grave, et que les pouvoirs publics avaient annoncé l’élargissement de la campagne de vaccination à 125 districts supplémentaires entre 2025 et 2029.
DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN
L’extraction minière et l’exploitation forestière illégales ont eu des effets désastreux sur l’environnement.
Selon les données mises à jour en 2024 par la plateforme en ligne Global Forest Watch, le Ghana a perdu 1,64 million d’hectares de couvert forestier entre 2001 et 2023, soit un recul de 24 % par rapport à l’an 2000. En octobre, la plateforme a enregistré 5 170 alertes à la déforestation en une seule semaine.
Le prix du cacao a continué d’augmenter en raison de la baisse des récoltes sur des terres qui, aux dires des producteurs et productrices de cacao, étaient ravagées par l’exploitation minière artisanale illégale (appelée galamsey) et par le changement climatique. Rien qu’en mars, les prix ont grimpé d’au moins 60 %. En outre, l’autorité de régulation du secteur cacaoyer du Ghana a indiqué que 500 000 hectares étaient infectés par le renflement des branches du cacaoyer, maladie peut-être favorisée par la déforestation et le changement climatique.
Conscient des dommages causés aux moyens de subsistance, l’État a annoncé en avril une augmentation de 50 % du prix payé aux cultivateurs et cultivatrices de cacao. Cependant, ceux-ci ont déploré l’insuffisance de cette hausse compte tenu du cours du cacao sur le marché international.
En octobre, des militant·e·s ont dénoncé les effets de l’exploitation minière illégale sur les cours d’eau après la publication d’un rapport de la compagnie des eaux du Ghana (Ghana Water Ltd) établissant que 60 % des cours d’eau étaient trop pollués pour être traités. Ces militant·e·s ont appelé le gouvernement à suspendre les contrats miniers et à prendre davantage de mesures pour mettre un terme à l’exploitation illégale.
Des textiles usagés issus de la fast fashion ont continué d’affluer de l’étranger et d’alimenter les marchés de seconde main, comme celui de Kantamanto, à Accra, avant d’être mis au rebut en raison de leur piètre qualité. Cette année encore, d’énormes volumes se sont échoués sur les plages et ont pollué les cours d’eau, les lagunes et l’océan.